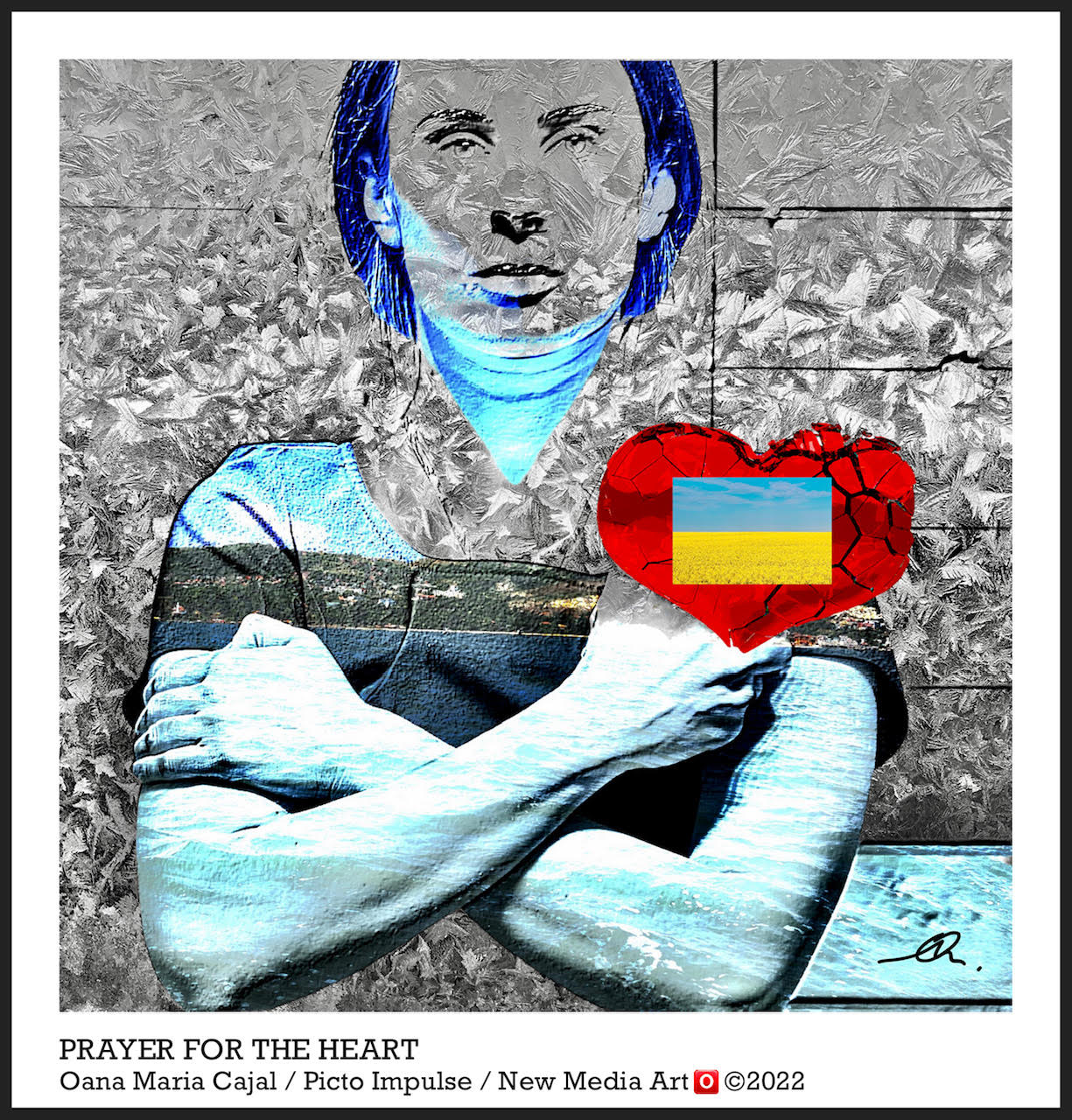« -Quel est le but de tout cela ?
-Peut-être qu’il n’y a pas de but ?
-« Cependant ! « et Pécuchet répéta deux ou trois fois « cependant » sans trouver rien de plus à dire. »
Bouvard et Pécuchet, Flaubert.
Dans les années 1950, Roland Barthes participe en tant que critique dramatique à la création de la revue bimensuelle Théâtre populaire créée en 1953, dirigée par Robert Voisin avec pour comité de rédaction : Roland Barthes, Guy Dumur, Morvan Lebesque, Bernard Dort, Henri Laborde et Jean Paris. La revue est alors installée dans le 6earrondissement de Paris, rue Saint-André des Arts et est publiée aux Éditions de l’Arche de 1953 à 1964. La revue se pense initialement comme le pendant théorique autonome de Théâtre National Populaire de Jean Vilar alors situé au Palais de Chaillot. Ces premiers textes sur le théâtre correspondent à une époque où le théâtre est un art très investi politiquement. À ce titre, Barthes s’inscrit dans une certaine histoire française du rapport au théâtre comme espace politique et utopique, on pense notamment au Living Theater fondé en 1947 et qui prend son essor dans les années 1960 au moment où Barthes délaisse le théâtre. En effet, à la suite de la découverte de Brecht, Barthes délaisse petit à petit le théâtre en tant que tel. C’est seulement à la fin des années 1970 qu’il se replonge dans ses textes de jeunesse à la demande de Jean-Loup Rivière – alors étudiant de Barthes dans le petit séminaire à l’École Pratique des Hautes Études – dans le but de faire un recueil de ses écrits sur le théâtre[1].
- Modifications de Barthes
L’ombre d’une lecture pointilleuse à l’excès qui voudrait à tout prix forcer le sens des modifications que Barthes apporte à ses écrits sur le théâtre, parus initialement dans la revue Théâtre populaire, puis repris à la demande de Jean-Loup Rivière, à la fin des années 1970, n’a cessé de planer sur cet article. Que faire de deux points qui se transforment en point-virgule ? de la suppression d’un tiret ? ou encore d’une correction orthographique ? L’énigme de l’abandon du théâtre par Roland Barthes dans les années 1950 demeure si forte, que l’on aimerait que dans ces modifications se révèle le sens le plus profond de ce délaissement, mais le « cependant » de notre exergue n’appelle peut-être, dans un premier temps, pas d’alternative.
Il apparaît donc nécessaire de commencer par faire l’hypothèse que ces modifications signalent une relecture des textes initiaux davantage qu’une réécriture. Travail de reprise dont Barthes dit à plusieurs reprises qu’elle provoque chez lui de la peur (« coincé par la peur : ou c’est raté -et alors blessure narcissique, découragement -, ou c’est bien, mais alors : c’était bien, impuissance à le refaire »)[2] mais dont il est coutumier puisque c’est un de ses modes de publications principaux, c’est déjà le cas des Mythologies et des Essais Critiques lorsque Jean-Loup Rivière lui fait la proposition de republication. Les modifications sont très souvent de l’ordre du détail, elles portent sur la ponctuation, l’orthographe, la suppression de certains sous-titres et la transformation de titres. Elles visent aussi à singulariser une écriture initialement élaborée dans l’entreprise collective de la revue comme le montre leur parution dans les Ecrits sur le théâtre. Ainsi certains textes parus anonymement, comme les éditoriaux, se révèlent être signés par Roland Barthes[3]. Cette singularisation de l’écriture va de pair avec une décontextualisation de celle-ci : on note la suppression de renvois qui sont faits par rapport à d’autres textes parus dans Théâtre populaire. L’écriture critique se déracine pour accéder à un discours plus théorique, ce qui est rendu particulièrement frappant par le passage du « je » à l’impersonnel « on » dans certains articles. Ce passage à l’impersonnel témoigne aussi de la distance avec laquelle Roland Barthes envisage ses écrits de jeunesse dans lesquels il ne se retrouve pas toujours.
- Du militantisme à la théorie politique.
Cette relecture conduit Barthes à apporter des modifications qui visent à simplifier le style, ce qui est un projet esthétique qui lui tient à cœur depuis la parution des Fragments d’un discours amoureux en 1977. Il cherche donc à rendre son écriture moins polémique comme le montre par exemple la suppression de certaines attaques ad hominem envers des critiques, dont peut-être les noms n’évoquent par ailleurs plus grand-chose aux lecteurs des années 1970. Ainsi, dans l’article « À l’avant-garde de quel théâtre ? » on passe de la phrase : « les « hardiesses » qui choquent tant parfois M. Gautier, sont, en fait et déjà, monnaie courante dans un art collectif comme le cinéma »[4] à : « les « hardiesses » qui choquent tant parfois la critique académique, sont en fait et déjà, monnaie courante dans un art collectif comme le cinéma ».[5] Barthes généralise son propos en effaçant les noms et on peut penser que cela lui permet aussi de faire accéder son discours au rang d’écrit théorique.
Dans la préface aux Ecrits sur le théâtre, Jean-Loup Rivière témoigne des réticences de Barthes au moment de cette relectures et il écrit au sujet des modifications apportées par l’auteur : « elles étaient idéologiques parfois, stylistiques souvent. Idéologiques quand les textes lui semblaient trop directement référés au sartrisme et au marxisme de sa formation intellectuelle, stylistiques par la récurrence d’un lexique qu’il avait abandonné. C’était surtout ce qu’il y avait de « militant » dans ces textes qui lui était insupportable. »[6]. En effet, certaines corrections portent sur le lexique mais pour autant il n’y a pas de refonte idéologique des articles de la part de Barthes. La relecture de ces textes passés constitue peut-être, pour Barthes, une expérience de ce que Freud appelle l’« inquiétante étrangeté », dans la mesure où Barthes revient à un discours qui était le sien et donc qui lui est familier, tout en même temps qu’il refuse de se reconnaître dans ce discours fasciné et virulent qui au moment de la relecture, n’est plus le sien.
Cependant, si le vocabulaire militant est supprimé, le message politique de ces textes n’est pas altéré pour autant. C’est ce que l’on peut remarquer dans l’article « Les maladies du costume de théâtre » paru initialement dans le Théâtre populaire n°12 de mars-avril 1955 où Barthes s’érige contre le souci esthétique portée aux costumes qui conduit à regarder indépendamment chaque élément de la mise en scène et évacue la possibilité d’une lecture totale de l’œuvre où chaque élément contribue à la compréhension d’un autre. Il écrit donc dans un premier temps : « c’est réduire l’œuvre à une conjonction aveugle de performances et de responsabilité »[7] pour ensuite reprendre « c’est réduire l’œuvre à une conjonction aveugle de performances »[8]. La comparaison des deux écrits montre que seule la notion très sartrienne de « responsabilité » est effacée. On peut même aller jusqu’à penser que dans l’article original cette notion est surajoutée à la phrase comme une manière de scander le discours. En effet, la phrase ne fait pas tellement sens dans la première occurrence d’autant que le terme « responsabilité » apparaît au singulier. Qu’est-ce qu’une conjonction de performances et de responsabilité ? La phrase se construit presque comme une synecdoque. On peut penser qu’il y avait alors chez Barthes la volonté de se constituer politiquement face à la figure de Sartre et donc d’emprunter les termes de celui qui représente alors l’intellectuel engagé. Vingt ans plus tard, Barthes cherche à renouer avec une pensée plus évidente et moins ampoulée qui se défait du surmoi politique sartrien.
- Barthes écrivain : un changement d’ethos.
Cette simplification du style va donc dans le sens de cet agacement face à un discours militant tout en même temps que cela désigne la volonté de se construire autrement, non plus en tant que critique journalistique mais comme écrivain. Les corrections apportées par Barthes, loin de conduire à une atténuation de son propos politique vont parfois jusqu’à l’accentuer, comme c’est le cas dans son article « À l’avant-garde de quel théâtre ? » écrit pour le numéro de Théâtre populaire du 1er Mai 1956. Ainsi, à l’alternative initialement proposée au sujet de la notion d’avant-garde : « qu’il fallait ou assumer ou contester. »[9], répond la suppression sans appel du choix proposé précédemment : « qu’il fallait contester. »[10]. La possibilité d’« assumer » le choix esthétique de l’avant-garde n’est plus une option intermédiaire possible pour Roland Barthes. Plusieurs autres suppressions ou modifications de Barthes vont dans le sens d’une affirmation politique plus tranchée et plus ferme que dans les écrits initiaux. C’est le cas aussi dans un article sur la mise en scène par Vilar de Ruy-Blas de Victor Hugo, où Barthes écrit dans un premier temps : « Ainsi, Ruy-Blas, selon Hugo concerne trois publics : les femmes, les penseurs, la foule, et chacun de ces groupes (à vrai dire plus psychologiques que sociaux) doit trouver dans la pièce pâture pour sa propre idéologie »[11]. Au moment de reprendre cet article il transforme la construction à valeur intensive « plus…que » en négation fermée « (évidemment psychologiques et non pas sociaux) »[12]. Le passage du Barthes critique au Barthes écrivain ne fait donc pas de lui un penseur apolitique ou dépolitisé, bien au contraire. Ce qui va contre toute une représentation de Barthes comme un penseur éloigné de la politique qui se serait replié vers l’intime. Si ce mouvement de l’écriture est bien réel chez Barthes, ce dernier donne aussi à l’intime une dimension davantage politique qu’individualiste et domestique.
En effet, sa pensée politique semble affermie et plus rigoureuse tout en même temps qu’elle se défait d’une certaine violence. Une autre correction va dans ce sens : il s’agit cette fois-ci d’un ajout fait entre parenthèse, et l’on sait que chez Barthes les parenthèses contiennent souvent l’essentiel. Il est toujours question de l’article sur la pièce de Victor Hugo, Ruy-Blas, paru dans les « Chroniques » de la revue Théâtre populaire de mars-avril 1954. Roland Barthes critique la mise en scène de Vilar qui reprend les codes de la comédie de caractères sans y parvenir et utilise le personnage moliéresque d’Harpagon pour servir de contre-exemple. Il écrit au sujet du nom d’Harpagon qu’il « vise à détruire par l’excès même de son principe toute une société, dissolvant, la famille, l’amour, toutes les constructions quotidiennes et réelles de la nature. »[13]. Lors du remaniement de ses textes Barthes écrit que le nom d’Harpagon « vise à détruire par l’excès même de son principe toute une société, dissolvant la famille, l’amour, toutes les constructions quotidiennes et réelles de la nature (ou de l’Histoire).[14] ». L’alternative ouverte par la parenthèse fonctionne comme un commentaire en marge et semble indiquer que le concept de nature n’est pas efficient pour la critique. C’est donc le Barthes des Mythologies qui intervient dans son texte pour donner une plus grande portée politique à son analyse à travers le prisme démystifiant de l’Histoire qui apparaît ici avec un grand « H » alors même que Barthes s’évertue tout au long de ses reprises à transformer la majuscule en minuscule.
Les corrections apportées par Barthes tendent à faire passer son propos du statut de critique journalistique militant à celui de critique théorique et d’écrivain. Ce déplacement de l’écriture va alors de pair avec une certaine narrativisation de celle-ci. On peut observer cette métamorphose du style dans les modifications apportées par Barthes au sein de son article intitulé Le Libertin (sur la mise en scène de l’opéra de Stravinsky). Il écrit d’abord : « Sortant du Libertin, il faut bien convenir que Faust représente toujours pour les Français l’état superlatif de leur opéra. »[15] pour réécrire ensuite : « Lorsqu’on sort du Libertin, il faut bien convenir que Faust représente toujours pour les Français l’état superlatif de leur opéra ». On passe alors du participe présent qui fait signe ici vers l’immédiateté d’un mouvement à une mise en récit introduite par la conjonction « lorsque ». A ce titre, il est intéressant de remarquer que Diana Knight dans son ouvrageBarthes and Utopia : Space, Travel, Writing[16], mentionne ce même phénomène de narrativisation du discours critique dans la reconfiguration des « petites mythologies du mois » parues dans les Lettres Nouvelles en livre, Les Mythologies. Comme si la mise en récit était le signe d’un passage de l’article à l’œuvre, du théâtral au romanesque. De la même manière la transformation de certains points ou deux points en points virgule construit la phrase comme une période et donc comme une écriture littéraire davantage que comme une écriture journalistique. C’est ce que l’on peut remarquer dans son article sur Le Plus heureux des trois de Labiche mis en scène par Robert Postec où Barthes écrit d’abord : « Le procédé est très simple : Labiche est soigneusement dissous dans le mythe 1900 : on sait que ce mythe fonctionne toujours comme un alibi d’irresponsabilité »[17] pour modifier ensuite la ponctuation : « Le procédé est très simple : Labiche est soigneusement dissous dans le mythe 1900; on sait que ce mythe fonctionne toujours comme un alibi d’irresponsabilité »[18]. La transformation des deux points en un point-virgule donne le sentiment que le discours est moins scandé et cherche à se fluidifier et la chronique se transforme en récit.
- Cependant, La Chambre claire : un théâtre en images.
Cette métamorphose de l’écriture barthésienne prend de l’ampleur au regard de ce que rappelle Jean-Loup Rivière dans sa préface : « Au moment où il relit ses textes anciens, il est en train d’écrire La Chambre claire, un livre sur la photographie où se retrouvent à la fois les conséquences les plus aiguës des réflexions anciennes sur le théâtre, et le cours plus récent de la méditation autobiographique. Le vieux style lui est insupportable, il le tire en arrière alors qu’un livre, nouveau à tous égard est en cours d’écriture. »[19]. Ce rappel contextuel nous permet d’énoncer notre seconde hypothèse d’analyse : La Chambre claire est le négatif (au sens photographique) des articles de théâtre repris par Barthes. Tout en nous inscrivant dans la lignée de Jean-Loup Rivière, nous proposons de considérer que La Chambre claire n’est pas un livre « nouveau à tous égards ». En effet, alors que les Ecrits sur le théâtre constituent une relecture critique des textes parus, entre autres, dans Théâtre populaire ; La Chambre claire en est la réécriture, la refonte théorique et littéraire. L’alternative au « cependant » énoncé dans le vide par Pécuchet donne bien, dans notre cas, suite à une seconde proposition et ouvre un autre champ d’analyse. Peut-être était-il impossible de creuser davantage le sens des modifications de Barthes, car le texte et partant le sens eux-mêmes s’étaient déplacés.
- Un contexte utopique.
On repère ainsi une structure en chiasme entre le début et la fin de l’œuvre barthésienne. Le contexte utopique dans lesquels s’élaborent ces textes semble se répondre de part en part de l’œuvre et se nouer autour de la photographie. À l’expérience pratique de l’élaboration d’un théâtre utopique dans les années 1950 avec le metteur en scène et l’acteur Jean Vilar répond le contexte d’une autre utopie pratique à partir de laquelle s’élabore le dessein de Jean-Loup Rivière. Celui-ci écrit au sujet de son projet de recueil : « [il] conserv[ait] pourtant une force encore fraîche dans la France d’après-Mai 68, dans la France post-gaullienne, à l’époque d’un mouvement artistique où le théâtre sortait des théâtres, où se répandaient les leçons de Grotowski, les expériences du Living Theater, etc. ».[20] Au théâtre utopique des années 1950 incarné par Vilar puis par Brecht répond l’utopie réalisée de Mai-1968, au sens où l’entend Louis Marin dans Utopiques : jeux d’espace. En effet, pour ce dernier Mai 1968 « a un rapport direct avec l’utopie, sinon dans certaines revendications qui s’y manifestèrent, du moins dans son caractère global de fête révolutionnaire. »[21].Par un effet de surimpression, l’on pourrait ajouter à cette construction en miroir, l’hypothèse selon laquelle Barthes propose dans La Chambre claire, une utopie théâtrale fictive et théorique. Nous définirons ici le terme utopie comme une construction fictive qui contient en elle l’esquisse d’un autre monde possible dans le non-lieu de l’imaginaire, qui, par le renversement qu’elle provoque contient une force subversive. Cette subversion tient au renversement que Barthes fait opérer à son écriture en passant de la scène à la salle. Andy Stafford défend cette idée d’une illimitation émancipatrice de l’écriture dans cette translation du théâtre au texte : « Barthes’s very training as a skillful and accomplished writer, a performer of language, was influenced by the destruction of the barrier separating the theatre (the theatrical) from the written text. »[22].
- Le théâtre utopique : entre écrit et image.
Il convient dès lors de s’interroger aussi sur une modification typographique importante entre les textes originaux et les textes tels qu’ils sont repris par Barthes. En effet, dans les Ecrits sur le théâtre, n’apparaissent pas les photographies qui accompagnent souvent les critiques de théâtre. Or, si ces photographies ne servent qu’à illustrer le propos tenu dans les articles, leur présence rappelle pourtant que la photographie est, dès le début de l’œuvre de Barthes, celle qui accompagne l’écriture et qui est associée au théâtre. Ce compagnonnage de la photographie et du texte est analysé notamment par Jacqueline Guittard qui écrit dans son article « La photographie : pour un locus amoenus barthésien » qu’on
« pourrait considérer sans exagérer que l’ensemble de l’œuvre de Roland Barthes est un dispositif photo-littéraire. Pour preuve, la galerie photographique qui s’est constituée au fil des ouvrages comme des textes théoriques comprend a minima 215 clichés, d’une extrême diversité. La photographie sémiologique – l’annonce-presse Panzani dans « Rhétorique de l’image » – et la photographie subjective de La Chambre clairetout particulièrement « Jardin d’hiver », ont connu une fortune telle qu’elles ont en quelque sorte occulté la part du corpus qui ne relevait ni d’une catégorie sémiologique, ni d’une catégorie nostalgique. » [23].
Le texte qui amorce le renversement de l’écriture barthésienne est l’article intitulé « Sept photos modèles de Mère Courage » qu’il propose dans le Théâtre Populaire du 3e trimestre 1959. La représentation théâtrale est alors immobilisée par les photographies de Roger Pic, la mise en scène se mue en une suite de tableaux vivants. Dans son ouvrage Roland Barthes contemporain, Magali Nachtergael écrit à ce propos :
« Entre Brecht et Barthes s’intercale donc un journaliste, Pic, mais aussi un art du photoreportage en plein essor ; et qui incarne une tendance majeure de la photographie contemporaine. La scène de théâtre se double d’une toute autre dimension, celle d’un théâtre des opérations qui vient témoigner des événements en différé, à la manière d’une reconstitution documentaire. Le théâtre des opérations, en termes militaires est un champ de bataille. Il est aussi l’hémicycle des écoles de médecine où la chirurgie s’expose in vivo. »[24].
Le recours à la photographie permet à Barthes de se faire le chirurgien d’un corps réduit à l’aplat de la page qu’il peut alors découper en laissant se déployer une jouissance fétichiste. Au colloque de Cerisy de 1977, Barthes explique à Raphaël Lellouche : « […]au cinéma j’aime toujours être au fond. […] les conditions de mon fétichisme iconique, c’est le cerné et l’éclairé, l’incarnation idéale de l’image cernée, éclairée, fétichisée, ce serait le tableau vivant, qui n’existe plus, qui marqué mon enfance par certains souvenirs. »[25]. La photographie et plus précisément le photoreportage apparaît comme le moyen pour Barthes de demeurer « au fond » de la salle. À cet égard, La Chambre claire constitue aussi un théâtre utopique au sens de théâtre heureux, dans la mesure où elle permet à la jouissance fétichiste de se déployer et même de se théoriser à travers la notion de punctum. Celle-ci s’est initialement élaborée à travers la réflexion de Barthes sur l’instant prégnant chez Brecht qu’il abord évoquée dans « Commentaire. Préface à Brecht, Mère Courage et ses enfants (avec des photographies de Pic) ». Ensuite, il l’a davantage théorisée dans « Diderot, Brecht, Eisenstein », où le recours à la transmédialité montre que la notion de théâtre se dépasse à travers celle de « tableau-vivant » qui transcende les arts. Le « tableau-vivant » apparaît alors comme ce qui permet d’associer l’animé à l’inanimé et d’opérer une translation du théâtre au texte. Le théâtre et le cinéma sont réduits au seul photogramme. Aussi la véritable opposition semble être davantage celle de la photographie et du texte avec en arrière-fond la question du politique.
- Une certaine pensée du texte.
La Chambre claire construit un théâtre utopique qui se tient dans un non-lieu imaginaire que construit le texte barthésien. Ainsi, l’espace théâtral s’immobilise à travers les photographies et s’anime par le commentaire qu’il en fait et par les possibilités fictionnelles que la critique déploie. Dans une interview du 1er janvier 1971, Barthes revient sur sa participation à la revue en expliquant que ce qui manquait le plus à Jean Vilar et à la revue Théâtre Populaire était un pendant théorique à l’élaboration pratique qu’ils proposaient. À ce titre, on peut penser que Brecht n’a pas uniquement été l’objet d’une fascination mortifère à la suite de laquelle Barthes aurait délaissé le théâtre. En effet, on peut supposer que la découverte de Brecht a aussi ouvert à Barthes un nouvel horizon d’écriture où théorie et pratique, critique et écriture se nourrissent mutuellement dans la mesure où chez Brecht, l’expérience pratique du théâtre va de pair avec son pendant théorique. Il y a, à ce titre, une dimension éminemment utopique de l’écriture barthésienne dans la mesure où son écriture critique tend constamment à devenir une écriture à part entière, débordant la structure théorique par la mise en récit de celle-ci. En effet, cette structure en deux temps, qui caractérise le travail de Brecht et que Barthes admire, est aussi ce qui caractérise le livre de Thomas More, Utopia. Dans son ouvrage, L’Utopie de Thomas More à Walter Benjamin[26] Miguel Abensour rappelle le lien indissociable entre les deux parties du livre de More et défend une lecture en deux temps qui ne ferait pas abstraction de l’une des deux parties du livre, l’une étant le miroir de l’autre. Or, chez Barthes cette lecture à deux temps se fait au sein même d’une écriture qui associe la mise en récit et la théorie critique, les entremêlant tout à fait au point même que l’on ne sait si Barthes doit être considéré comme un écrivain ou comme un critique. Au sujet de cette articulation du théorique et du pratique au sein même de l’écriture, Christophe Bident écrit : « La théâtralité, ce serait donc l’exposition, l’explication et la distanciation des signes. En ce cas, Barthes emprunte bien le modèle de sa pensée au théâtre. Il faut dire que le théâtre est un référent constant de la phrase. ».[27]
Finalement, la relecture à laquelle se livre Barthes à la demande de Jean-Loup Rivière donne à La Chambre claireécrite au même moment, un éclairage particulier et tisse un lien particulièrement vivace avec l’utopie du théâtre populaire des années 1950. Dans Roland Barthes par Roland Barthes, celui-ci écrit : « Au carrefour de toute l’œuvre, peut-être le Théâtre »[28]. L’influence du théâtre dans l’œuvre de Barthes est d’une grande importance comme l’ont montré Andy Stafford[29] et Christophe Bident, mais cette influence semble se réaliser particulièrement dans les dernières œuvres et particulièrement dans La Chambre claire. Le théâtre y apparaît comme un modèle qui structure le texte et qui l’informe, créant ainsi une forme de théâtre textuel réduit à l’aplat de la page.
[1] Roland Barthes, Écrits sur le théâtre, (ET)Paris, Seuil, 2002. [2] Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur, Paris, Seuil, 2010, p. 101. [3] Roland Barthes, ET, op.cit. [4] Roland Barthes, « À l’avant-garde de quel théâtre ? », Théâtre populaire n°18, 1er mai 1956, (noté désormais TP n°18, le chiffre arabe indiquant le numéro de la revue), p. 3 (nous soulignons). [5] Roland Barthes, « À l’avant-garde de quel théâtre ? »ET, op.cit., p. 205, (nous soulignons). [6] Roland Barthes, Préface, E.T, op.cit., p. 11. [7] Roland Barthes, « Les maladies du costume de théâtre », TP n°12, mars-avril 1955, p. 68. [8] Roland Barthes, « Les maladies du costume de théâtre », E.T, op.cit., p. 140. [9] Roland Barthes, « À l’avant-garde de quel théâtre ? », TPn°18, op.cit., p. 1. [10] Roland Barthes, « À l’avant-garde de quel théâtre ? », E.T, op.cit., p. 202. [11] Roland Barthes, « Ruy-Blas », TP n°6, mars-avril 1954, p. 93, (nous soulignons). [12] Roland Barthes, ET, op.cit., p. 72, (nous soulignons). [13] Roland Barthes « Ruy-Blas », TP n°6., p.94. [14] Roland Barthes, E.T., op.cit., p. 73, (nous soulignons). [15] Roland Barthes, TP n°1, mai-juin 1953, p. 87. [16] Diana Knight, Barthes and Utopia : Space, Travel, Writing, Clarendon Press, Oxford, 1997. [17] Roland Barthes, TP n°19, juillet 1956, p. 80. [18] Roland Barthes, E.T, op.cit., p.193, (nous soulignons). [19] Roland Barthes, E.T, op.cit., p. 11. [20] Ibid, p. 10. [21] Louis Marin, Utopiques : jeux d’espaces, Paris, Minuit, 1973, p. 15. [22] Andy Stafford, « « Mise en crise » : Roland Barthes from Stage to Text » in Powerful Bodies, Performance in French Cultural Studies (vol. 1), dir. V. Best & P. Collier, Bern, Peter Lang, 1999, p. 149. [23] Jacqueline Guittard, « Pour un locus amoenus barthésien », in Espaces phototextuels (dir. D. Méaux), Lille, Revue des Sciences Humaines, 2015,p. 139. [24] Magali Nachtergael, Roland Barthes contemporain, Paris, Max Milo, 2015, p. 52. [25] Jean-Loup Rivière, « La déception théâtrale », Prétexte, Roland Barthes, Cerisy 1977, Christian Bourgeois, 2003, p. 142-143. [26] Miguel Abensour, Utopiques III, l’utopie de Thomas More à Walter Benjamin, Paris, Sens&Tonka&Cie, 2016. [27] Christophe Bident, Le geste théâtral de Roland Barthes, Paris, Hermann, 2012, p. 31. [28] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Œuvres complètes, t. IV, Editions du Seuil, 1975 p. 749. [29] Andy Stafford, « « Mise en crise ». Roland Barthes from Stage to Text », in V. Best & P. Collier (dir.), Powerful Bodies. Performance in French Cultural Studies, Berne, Peter Lang, 1999, p. 149-163.