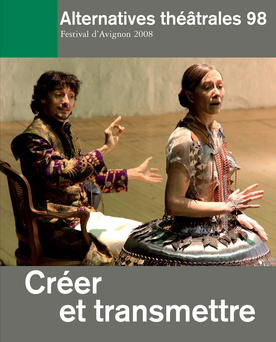Ce texte a été initialement été publié en 2008 dans le n° 98 d’Alternatives théâtrales (« Créer et transmettre »). Nous le reprenons ici dans le cadre des extensions numériques du n° 149 (juillet 2023) de la revue : « Théâtre/Paysage ».
Deux techniciens répandent successivement, à l’aide d’un tamis, une poudre blanche sur la surface des trois bassins rectangulaires qui s’offrent à nos yeux, l’un derrière l’autre, au début du spectacle ; puis ils disposent trois tuyaux plastiques par lesquels s’écoulera l’eau qui la dissoudra peu à peu. Ce sera la seule intervention humaine qui nous sera donnée à voir dans Stifters Dinge. Au fond, une masse encore comme sans relief se distingue : un collage de pianos, en tous sens, cordes à nu, d’où émergent comme d’une montagne des branches d’arbres. « Une œuvre pour piano sans pianiste mais avec cinq pianos, une pièce de théâtre sans acteur, une performance sans performer – un non one-man show ou peu importe la dénomination qu’on choisira »[1] : installation ou composition pour pianos mécaniques, sons, eau, lumières et autres choses, Stifters Dinge (« Les choses de Stifter ») présente un paysage dont l’homme se serait absenté.
Paysage tout en profondeur et non panoramique, où le regard donne sur les trois petites étendues d’eau puis, comme sur un horizon, sur le massif chaotique de pianos auquel les variations lumineuses donneront relief, ou sur l’écran qui descend par moments devant lui pour diffuser la lumière, filtrer l’éclat d’un projecteur ou devenir surface de projections — d’une image (marais et bosquet sur un tableau du XVIIème siècle) ou des reflets de la lumière sur la surface de l’eau devant lui. Car ce qu’il y a à voir, dans cet espace sans homme et ce temps sans drame, ce sont les événements produits par de telles variations : des lignes géométriques qui se tracent ou un ballet de rectangles lumineux se déplaçant sur le sol, le jeu de la lumière sur les surfaces, un nuage de fumée s’élevant entre branches et pianos, une fine pluie qui tombe sur l’étendue lisse de l’eau, la lente dissolution de poudre dans des lacs miniatures – jusqu’au bouillonnement final de carboglace, comme autant d’îles et de geysers au milieu de mers immenses, se dissolvant jusqu’à ce que la surface de l’eau soit recouverte d’une couche blanche se défaisant alors en un progressif dégel. Une averse, de la neige, les formes dessinées par des soleils rasants ou tombant du zénith de la scène… Des variations climatiques. Le dispositif scénographique de Klaus Grünberg et la suite des séquences scéniques construites autour de lui instaure alors une temporalité qui n’est plus celle de l’activité de l’homme, mais celle d’un cours naturel.
Nulle action humaine, nul drame si ce n’est celui du regard, et de l’écoute, de l’attention aux sons, aux mouvements lumineux, et à leur articulation au temps : le temps qui les fait voir, l’autre temps qu’ils font percevoir. Se déploie ainsi, concentrée en une heure dix, la contemplation d’un monde en miniature où s’offrent à nos yeux les mille et une nuances d’un après-midi d’hiver (ou d’un hiver entier, on ne sait plus) : un paysage sans cesse changeant, à explorer (comme ces terres inconnues à découvrir, dont Levi-Strauss regrette la disparition dans un extrait d’entretien diffusé dans le spectacle) et face auquel il nous faut faire l’expérience d’un regard vierge.
Il nous faut voir, donc, percevoir les « choses ». Il nous faut aussi entendre, la composition musicale de Goebbels : piano, voix humaines et chants « primitifs » de Papouasie, de Colombie ou de Grèce, mais aussi les sons produits par les cordes frottées ou tapées, par de l’air projeté dans de longs tubes, les craquements ou les frottements d’une matière sur une autre matière. Il nous faut aussi voir-entendre : le deuxième mouvement du concerto italien en fa majeur[2] de Bach joué, tandis que tombe l’averse, par un piano mécanique, les touches précisément éclairées mues sans doigts pour les actionner ; l’avancée vers la face du bloc de pianos, jouant tous ensemble comme une machine folle, comiques, menaçants, impressionnants. Il nous faut entendre-voir, enfin : la stupéfiante description, extraite des Carnets de mon arrière grand-père d’Adalbert Stifter, dont la lecture est diffusée durant une séquence du spectacle : celle d’un paysage, en lisière d’une forêt, entièrement pris par le givre, pétrifié-vitrifié, traversé de craquements et de bruits sourds – ceux des branches et des arbres qui se brisent et s’effondrent sous le poids du gel. Un spectacle étrange, où l’effroi se mêle à la beauté[3], fascinant :
« Je n’avais jamais vu cette chose aussi bien qu’aujourd’hui. (…) La pluie avait tout recouvert de glace fraîche. (…) Quand bien même c’était encore le début de l’après-midi, quand bien même le ciel gris irradiait une lumière claire, comme si on aurait dû voir le soleil briller à travers les nuages, c’était pourtant bien un après-midi d’hiver et il faisait si sombre que déjà les champs blancs devant nous commençaient à changer de couleur (…). C’était inimaginable, la splendeur et le poids de la glace accrochée aux arbres. Les conifères étaient pareils à des candélabres où pendaient d’innombrables bougies, dirigées vers le sol, aux dimensions fabuleuses. (…) Dans tant de scintillement et de chatoiement, aucun rameau, aucune aiguille ne bougeait, sauf après une chute de glace lorsqu’une branche battait l’air. Ensuite tout redevenait calme. Nous attendîmes, et regardâmes, je ne sais pas si c’était par admiration ou par peur de nous engager dans la chose.
Et lorsque nous regardâmes en arrière, vers les champs par lesquels nous étions venus, comme nous l’avions constaté tout au long de la journée, il n’y avait ni être humain ni créature vivante, uniquement moi, Thomas et l’alezan, seuls en pleine nature »[4].
Face à – ou, plus encore : pris dans – ce paysage d’hiver, dont tout le spectacle semble décliner les motifs, l’homme est saisi – dans l’expérience d’un dessaisissement, celui de sa maîtrise et du sentiment de sa centralité. Le regard ainsi instauré implique un changement d’échelle, il produit une radicale relativisation de la place de l’homme, et par conséquent son ouverture à l’infinitude concrète de ce qui l’entoure, du temps et de l’espace dans lequel il s’inscrit, d’un ordre naturel autonome. Viennent alors à l’esprit les dernières lignes des Mots et les choses de Foucault : « alors on peut bien parier que l’homme s’effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable »[5]…
C’est bien ce même changement de perspective que met en œuvre le paysage artificiel et miniature conçu par Goebbels et Grünberg, articulant (de manière toute stifterienne), inséparables, le sentiment de l’infiniment grand et celui d’un infiniment petit parcouru d’une vie multiple : la conscience de l’immensité et de l’organicité naturelles y passe par l’attention au détail de chaque chose, de chaque phénomène. Et s’il offre à l’imagination montagnes, vallées et couchers de soleil dans la brume, c’est sur un plateau aux dimensions restreintes, c’est sur trois petits bassins géométriques que se donnent à voir lacs et mers, ce sont des lumières finement ciselées et ciblées qui laissent deviner, dans leurs contre-jours, des masses rocheuses… Cadrage et micro-focalisations ouvrent la perception, et avec elle l’imaginaire. C’est ainsi qu’une séquence voit un petit écran, suspendu dans les cintres, se promener, révélant, au fur et à mesure de ses légers déplacements, quelques feuilles d’arbres, un branchage, un tronc, une forêt, des animaux, des chasseurs : fragment par fragment, La Chasse nocturne de Paolo Uccello – projetée entièrement dans tout l’espace scénique mais que seule l’interposition de l’écran révèle, un détail après l’autre. La fragmentation du regard fait apparaître l’ensemble – de la scène, du paysage –, sans jamais le donner comme tel.
C’est sans doute entre autres parce qu’il suscite ainsi un regard attentif à ses multiples détails, plus que soucieux de saisir et résoudre son fonctionnement d’ensemble, que le dispositif, aussi global qu’il puisse être, n’apparaît jamais comme une machine monstrueuse[6], échappe à la logique de la succession d’effets et de la démonstration technologique. La prouesse technique que représente sa conception s’efface devant la vie propre de l’objet présenté : le mécanique disparaît devant l’organique. Ce dispositif, tout immensément complexe qu’il soit, n’est d’ailleurs composé que de constituants les plus élémentaires qui soient – de l’eau, de l’air propulsé, des cordes qui vibrent, de la lumière… –, associés en un bricolage de génie, certes, mais un bricolage : du capharnaüm des pianos désossés et empilés à la simplicité naïve et ravissante des expériences qu’il produit sur la scène, il garde toujours quelque chose de ludique, voire d’enfantin. Plus encore, dans cette re-création factice d’une nature miniature, d’un tout autonome fonctionnant à l’image d’un paysage naturel, il assume absolument, avec ses écrans, ses faisceaux de projecteurs ou les grands jerricans plastiques illuminés qui bordent l’espace, la complète artificialité qui est la sienne. En conclusion de Sur le théâtre de marionnettes, Kleist écrivait en substance que l’état d’innocence étant perdu, le paradis étant « verrouillé », la grâce ne pouvait resurgir qu’une fois la conscience passée par le détour de l’infini, et ne pouvait apparaître que sous les aspects d’une conscience infinie ou sous celle d’une marionnette sans conscience. Le dispositif mécanique et technologique conçu pour Stifters Dinge, où ironiquement ce seront les pianos qui viendront saluer à la fin de la représentation, suscite ainsi le sentiment de l’évidence naturelle par le détour d’une installation absolument artificielle, par le détour de l’art.
Et, s’il suggère la possibilité de la disparition du sujet humain comme la fin d’un moment parmi d’autres de l’histoire naturelle, s’il implique le constat de la finitude de l’homme en l’absentant ainsi, le paysage qu’il crée se donne cependant à voir à celui-ci : dans la boîte optique de la scène, il s’offre à nous, spectateurs, dans une relation esthétique qui fait de ses tableaux des objets de rêverie et de fascination pour le sujet regardant (il peut produire par moments l’impression d’avoir « les paupières coupées », pour reprendre l’expression célèbre de Kleist[7]), dans une contemplation qui ne se résout cependant pas (du fait, en particulier, du cadrage et du montage qui président au déroulement du spectacle) en une projection fusionnelle, les choses gardant toute leur étrangeté, leur résistance à la simple appropriation. Paysage romantique et « postmoderne » tout à la fois, il révèle un monde à voir, et (comme chez Stifter le monde, s’il dépasse l’homme, est à habiter et cultiver par lui) à la vie multiple et infinie duquel il nous appartient de prendre part, selon une juste mesure.
Après la représentation, les spectateurs se pressent sur les bords du dispositif scénique pour en regarder de plus près et sous une lumière neutre les éléments et les articulations, entraînés par la curiosité de voir et de disséquer la fabrique, qu’accompagne pourtant le sentiment que cette révélation technique détruira le charme du spectacle. Il n’en est cependant rien : la déambulation s’attache aux multiples petits éléments qui constituent le dispositif sans jamais en saisir l’ensemble, le regard s’attache là encore aux détails dans une perception parcellaire, on parcourt les bords du plateau au milieu des craquements, souffles et frottements du mécanisme toujours en mouvement, de sa vie étrange et perpétuelle – comme une forêt à la lisière de laquelle on se promènerait.
[1] Stifters Dinge, livret de photographies de Mario del Curto et de textes publié à l’occasion de la création du spectacle en septembre 2007 au Théâtre Vidy-Lausanne.
[2] BWV 971.
[3] En une expérience esthétique et éthique qui n’est pas sans rappeler Heiner Müller : des « paysages » mülleriens à ceux de Stifter, ce sont les mêmes interrogations de la perception, et anthropologiques, que creuse Heiner Goebbels.
[4] Traduction de René Zahnd pour le spectacle. En français, les romans et nouvelles d’Adalbert Stifter (1805-1868) sont publiés chez Jacqueline Chambon (dont Les Carnets de mon arrière grand-père), Gallimard, Phébus et Circé.
[5] Que l’on retrouvera dans le livret cité plus haut.
[6] Seule l’avancée de l’ensemble des pianos, tous en jeu, jusqu’à l’avant de la scène donne, un moment, cette impression et peut évoquer le danger d’une humanité dépassée par les monstres technologiques qu’elle a créés. Ce moment peut apparaître, lorsqu’il advient, comme un potentiel clou final, clôturant alors le spectacle en coïncidence avec un propos écologique qui ne lui est en rien étranger. La représentation ne s’arrête cependant pas là : des voix reviennent, les mers bouillonnantes apparaissent derrière le recul des pianos, le dégel viendra…
[7] « Impressions devant un paysage marin de Friedrich » [Le Moine au bord de la mer], in Petits écrits (Œuvres complètes, tome 1), trad. P. Deshusses, Le Promeneur-Gallimard, 1999.