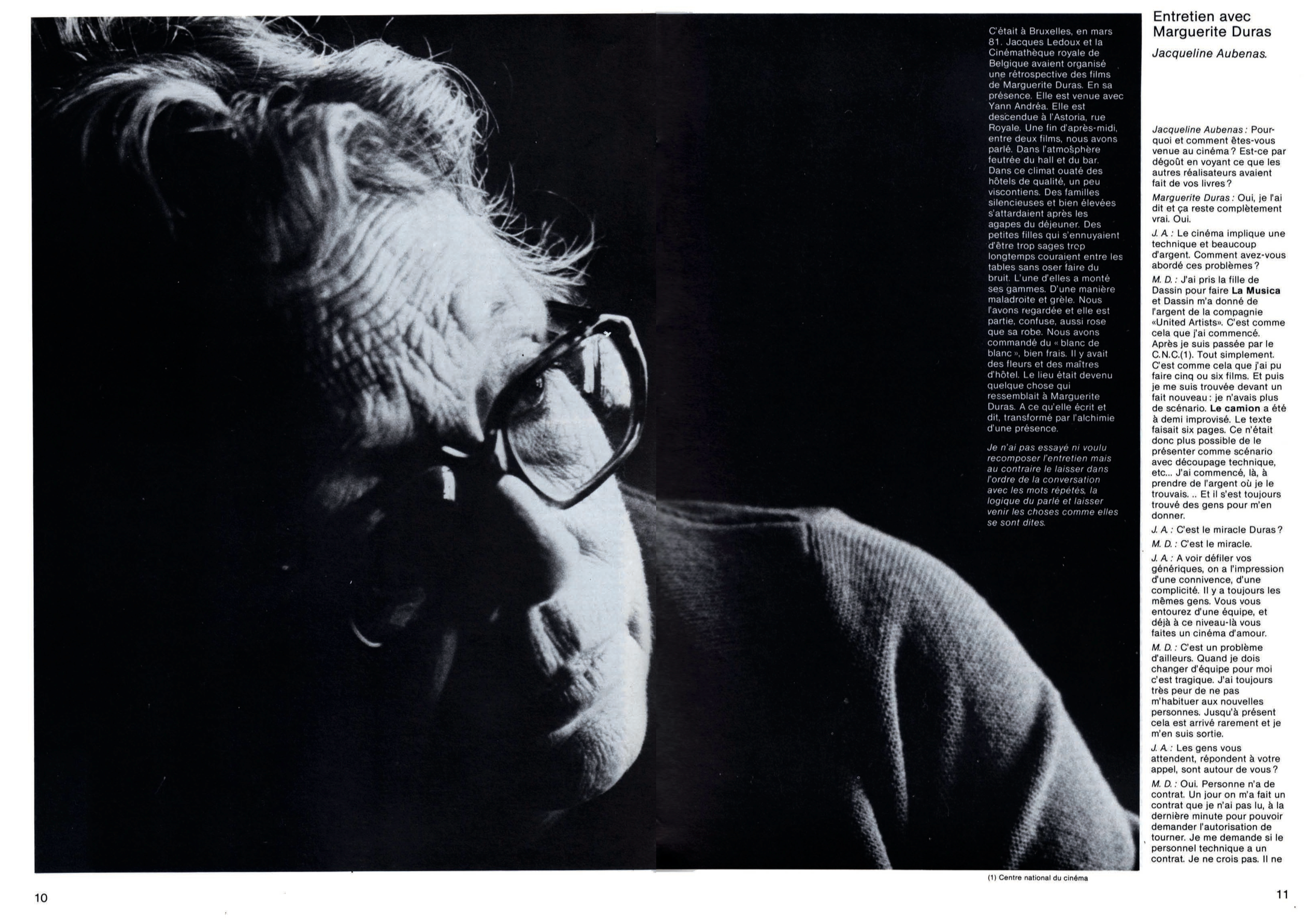J. A. : Vous mettez à nu le cinéma, l’amour, la méchanceté.
M. D. : Je ne les accuse plus. Je permets de les admettre. Voir est déjà intolérable, dur. Alors, le dire ! J’ai envie de tuer les assassins de Goldmann par exemple. Je ne suis pas bonne moi-même. J’appartiens comme tout le monde à la malfaisance. Et je réponds à la malfaisance du monde par la mienne. Il y a des rapports comme cela entre les gens. Il est certain que si j’avais pu les tuer je l’aurais fait, abattus comme des chiens. Je suis dans ce naturel. Il faut quand même qu’on le retrouve ce naturel. Et le meurtre en fait partie. Dans Outside j’ai écrit : « le rêve heureux du crime ». Tout le monde en parle. Je dis que je suis capable de meurtre mais que la différence entre un nazi et moi c’est que je sais que je suis capable de tuer. Le nazi avait la naïveté de croire qu’il n’en était pas capable, il le justifiait. C’est un manque d’imagination. La femme qui porte un manteau de bébé phoque blanc neigeux, de cet animal assassiné, et qui porte ça, à Dallas, en toute tranquillité, on ne peut plus rien faire pour elle. Elle est complètement perdue. Avec les millions de mots qui ont circulé sur le massacre, elle sait mais elle manque d’imagination. Elle est elle-même au plus près du meurtre. Je suis séparée d’elle. Je ne peux rien pour elle. Elle ne me donne même pas envie de tuer. Elle est perdue. Ce qui me bouleverse profondément c’est que les assassins de Goldmann étaient des gamins de 18 ans. Pas de vieux criminels rassis. Des enfants payés. Presque rien. Pour tuer Goldmann. Dont ils ignoraient tout.
J. A. : Mais à un moment avez-vous cru à un système réformateur ?
M. D. : Oui, bien sûr, puisque j’étais communiste. Peut-on dévoyer la malfaisance ? Je fais dire à Walesa: « le mal aussi peut servir. Il suffit de le détourner »…
J. A. : Mais comment ?
M. D. : L’envie de tuer est une constante de ma vie. Je le dis. C’est une des constantes les plus constantes…
Y. A. : C’est le tabou social numéro un. S’il n’y avait pas cet interdit-là, il n’y aurait aucune société possible. Freud a été très clair là-dessus.
M. D. : Freud n’a pas été moraliste. C’est la philosophie qui l’est. Des gens comme Kierkegaard, Sartre, sont moralistes. Kierkegaard au moins se laisse aller à son écriture, à son génie. Sartre non. lI ne faut pas oublier que l’existentialisme est une morale. De A à Z. Ils nous font chier avec ça depuis 25 ans. Le communisme est aussi la plaie morale. Il n’y a pas un mot qui là ne soit pas d’ordre moral. L’ennui mortel est la morale. Là c’est pire que la morale chrétienne.
J. A. : Comment en êtes-vous sortie ?
M. D. : J’ai été mise à la porte, foutue dehors. Je n’en ai pas souffert longtemps. Mes amis si. Nous étions onze. Mon mari a failli en mourir. D’autres ont été très atteints ; d’autres sont devenus des fascistes. Morin, lui, a nié, l’expérience, le passé. Je lui en ai voulu… Eux me donnent envie de tuer. Comment supporter, admettre ça. Vous savez ce qu’ils ont fait avec le foyer des ouvriers maliens? C’est un maire communiste qui a permis cette horreur.
J. A. : Vous n’avez pas envie de faire des articles ?
M. D. : Il ne faut plus écrire là-dessus, plus écrire sur le P.C. Du tout, du tout. Ce n’est plus la peine. Il faut les laisser mourir, sans un mot. Comme ce renouveau de fascisme qu’il y a à propos du martyr des juifs, le massacre des 7 millions, maintenant il y a des gens qui font carrière en disant qu’il ne s’est rien passé, que l’histoire est fausse. Si personne ne reprend ces absurdités, elles tombent. C’est la où le journalisme est criminel : ce n’est pas de dénoncer, c’est de reprendre. Il y a la déontologie du silence. C’est le seul remède. Que faire contre ça? Ne pas le relever. En faire une parole pour rien. On se sert des nazis avec des fouets dans les films pornos. Personne ne les dénonce. ll faut faire pareil. Pas de critique. J’ai eu honte pour elle, pour une femme, pour Cavani, quand j’ai vu Portier de nuit.
J. A. : Quelles sont vos actions face à tout cela, à part le silence ?
M. D. : J’aide les objecteurs de conscience. J’ai prêté mon appartement pour des conférences de presse. Je signe tout. J’ai une appartenance qui est mon identité véritable, à Amnesty. Ils se servent de mon nom. Je leur ai donné. Je leur fais confiance. Pour défendre des syndicalistes somaliens ou des savants soviétiques. C’est mon identité. La seule. Mon sentiment du mal va de pair avec celui d’une absurdité irrémédiable, liée à l’acte de naissance. Je suis arrivée à peu près à une quasi indifférence quant à ma mort. L’idée de ma mort est liée à la totale inanité de l’effort, pour essayer de redresser le mal donné du monde. il y a une maldonne essentielle qui n’est pas loin d’une idée de Dieu. La vie est un accident mathématique, comme il y a la bactérie de la grippe il y a le virus de la vie. Ce n’est pas un désespoir. Le désespoir c’est quand j’espérais. Je suis comme cela depuis très longtemps; très tôt. J’ai failli mourir quand j’avais 33 ans. Une fausse couche. J’étais vidée de mon sang. On a dû faire deux transfusions. On ne parvenait plus à me rattraper. J’étais complètement tranquille. Je riais. Je disais que je ne sentais plus rien. J’entendais mon mari hurler, sangloter. C’était doux, agréable, il y avait comme un consentement. Ce n’est pas une question d’âge, d’expérience… Le seul avantage d’être sortie de moi-même, d’être allée dehors, «outside», comme je l’ai fait pendant 10 ans de militante, c’est que les raisons que j’aurai eues de mourir étaient extérieures à moi. Comme le sort fait au juif, la douleur de voir les gens torturés, l’injustice faite aux arabes pendant la guerre d’Algérie, la nuit des Rosenberg où j’ai été arrêtée, ce sont des raisons extérieures à ma vie : une leçon politique à tirer de l’erreur politique car c’est une erreur politique de militer dix ans mais que je ne regretterai jamais. C’est ça, cette vie qui s’étend à l’extérieur, qui devient tentaculaire : on n’est plus seulement porteur de sa vie mais porteur d’autre chose, de plus grand que vous, que j’appelle l’altérité peut-être. Les jeunes qui n’ont pas l’expérience politique subissent un appauvrissement très grave.
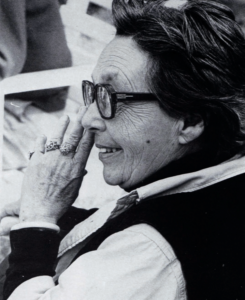
J. A. : Quel est votre désir maintenant?
M. D. : Faire du cinéma. des livres. Je ne sais pas bien pourquoi. Pour écrire Agatha je me suis assise à une table pendant 43 jours. Cela me demeure curieux. Maintenant quand j’entends Agatha, je suis complètement épatée… Ce que je dis est le contraire de la prétention.
Y. A. : On bute toujours là-dessus. Un auteur ne peut pas rendre compte de ce qu’il écrit. Juste en parler. Elle assiste a la venue de l’Autre, du texte. Ce doit être assez troublant. Mais, comme elle dit, c’est le contraire de la prétention. Complètement.
M. D. : J’ai connu Yann au mois de septembre. Il est arrivé chez moi. Comme Ça. Il est resté. Exactement. C’est vrai. Il m’a vue faire la fin de L’été 80. C’est beaucoup de travail, beaucoup de travail, pour faire trois ou quatre pages je mettais trois ou quatre jours. Et après il me lisait mes textes et j’étais éblouie. Maintenant on me laisse parler de ça. Avant, mes hommes, mon mari, me disaient « mais tu es folle, on ne parle pas comme cela de soi-même ». Je ne peux pas m’empêcher de dire comme
c’est bien. Pourquoi m’en empêcher? Et Yann aussi en parle comme d’un texte qui n’est pas de moi. D’un tiers.
… Envoyez-moi le texte, je dis des choses sur la mort et la malfaisance que je n’avais jamais dites.
J. A. : Revoyant vos premiers films où vous ne parlez pas, entendre vos mots dits par les autres m’était une gêne.
M. D. : Oui. Vous vous rendez compte que je ne peux pas les faire traduire maintenant mes textes. Les gens veulent ma voix, donc je me barre complètement le reste du monde, avec ma propre voix. Les américains ne veulent que des copies sous-titrées. À Rotterdam aussi. Je me fais du tort, autrement dit.
J. A. : Votre voix serait-elle une réécriture, une recréation ?
M. D. : Ce n’est pas ma voix, c’est la voix.
Y. A. : La voix c’est quelque chose qui appartient à quelqu’un de très singulier qui fait passer le désir. On désire cette voix.
M. D. : Les comédiens disent bien, mais un bien qui ne vous révèle rien. On donne à un comédien un sujet, un verbe, un attribut, un complément, et il leur donne un sens. Moi je laisse démantelé. Cela dépasse tous les systèmes de ponctuation.
Y. A. : Une création est un rythme. Dans un texte de Duras tout s’écroule s’il n’y a pas ça. C’est un ensemble très fragile… Il est détruit s’il est dit correctement et banalement.
M. D. : Maintenant j’ai faim. Et à quelle heure faut-il être à la Cinémathèque?
La voix s’est tue.
Ce texte a été publié dans le numéro 14 d'Alternatives théâtrales, consacré à Marguerite Duras en 1983.